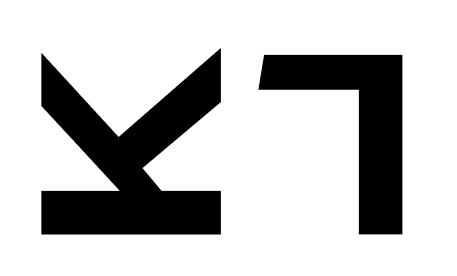Je continue à faire faiblir la lumière certains jours, quand l’offensive est trop âpre, quand la nuit me récite les mots. Je voudrais les ternir, n’avoir des marques que sur mon corps, que ma pensée n'ait été qu’éclaboussée. Je m'astreins à penser à ne plus y penser, pourtant en ne pensant à rien, je produis de la matière vierge.
Je n’aime pas parler, même quand je parle beaucoup, j’ai toujours préféré écrire, j’y trouve autre chose -alors que ce sont les mêmes mots- dans la restitution, dans l’imagination, pour inventer le ton, supposer le début d’une histoire, pourtant, je me suis sentie confisqué cet espace, comme tant d’autres. Je le réinvestie à pas de loup, sans certitude, j’ai appris à ne plus pressentir, à laisser le sort décider, à ne penser qu’à l’instant. Si j’accepte le chemin, je ne connais pas la fin, et je ne la cherche plus, parce que j’ai maudit tous mes mots quand je les relisais, j’ai maudit tous mes sens quand je les traversais, j’ai maudit d’avoir su, j’ai maudit d’avoir cru. Alors je fais de mon histoire, des histoires, une constellation imparfaite où se chevauche les ponts, les tunnels et les routes. Je désagrège l’histoire en des histoires pour ne plus être un monolithe, pour être toutes celles que j’ai été en même temps, sans désavouer leurs incohérences et leurs peurs. En morcelant, je laisse la peau d’une d’entre elle dans le labyrinthe, puis, je la couvre de soie pour la réparer, je l’autorise à pleurer pour nettoyer, pour effacer chaque phrase et tous les mots, pour oublier chaque ruse et tous les sauts, je l’excuse d’avoir parcouru l’ombre, d’avoir perdu un bout d’elle-même, d’avoir flanché cette nuit de printemps. Je lui raconte une autre histoire où les mots ne sont plus des dagues, où les mots veulent toujours dire ce qu’ils sont.
En écrivant ces mots, je me demande, combien de femmes ont besoin de rentrer à la maison ? Combien de femmes ont besoin de se morceler pour exister ? Mon histoire -mes histoires- sont de l’ordre de l’ordinaire, la violence des hommes -peu importe sa forme- est de l’ordre de l’ordinaire. Je ne trouve que trop rarement ces histoires-là, on en fait peu de films, de séries, de romans. Où sont ces histoires-là ? Celle que je connais par cœur, que je pourrais réciter, parce que ce sont les miennes et celles de toutes les femmes que j’ai aimé. Elles n'existent que dans des espaces clos, elles se rendent absentes dans l’espace public comme si la violence des hommes était toujours domestique, dans sa réalisation et dans son récit. Comme si raconter, c’était raconter l’extraordinaire et je me demande combien de fois, j’ai eu peur de nommer les choses, comme si nommer la violence, c’était m’en rendre responsable, comme si la vivre, c’était presque toujours l’avoir demandé. Je disais à une amie il y a quelques temps, on n'arrive jamais par la violence et on ne reste -non plus- jamais pour cette raison-là, même quand elle ne nous semble plus si grave, même quand on finit par croire qu’on en est responsable, même quand on la confond avec de l’amour. Pourtant, la violence et l’amour ne peuvent jamais coexister, c’est antinomique (du grec antinomia “contradiction entre les lois”). La violence, c’est la contradiction de l’amour, c’est ce qui nous en éloigne, alors j’ai tatoué le mot amour sur mon corps, pour me souvenir, porter ce rappel, les jours où je rentre en contradiction.
Je crois que j'ai toujours écrit, je ne me rappelle pas n'avoir passé un seul moment sans écrire, des journaux, des poèmes, des nouvelles, des phrases, des mots. J’ai toujours vécu à moitié dans la matérialité du monde, à moitié dans l’immatériel de mon esprit. J’ai imaginé des suites, à tout ce que j’ai vécu, le sourire qui ne dure qu’une seconde et l’amour qui s’ancre depuis toujours, j’en crée des amas de mots-clés, pour savoir où me diriger. Cette imagination, c’est mon retour à l’enfance, mon lien à celle que j’ai été petite. Je porte un regard enfantin, innocent sur l’imagination, inoffensif. Mais je reviens d’un endroit où l’imagination était l’arme de la violence pour ne pas se nommer, pour se grimer d’autres images, pour se placer en victime de ses propres méfaits. Cet endroit a colonisé mon esprit, terni la naïveté de mon imaginaire, a attaqué mon repli du monde. Mon imagination était orgueilleuse, elle trouvait toujours réponse à tout, elle a dû apprendre à laisser des questions sans réponse, jusqu’à ce que les questions disparaissent et forment le nouvel imaginaire, puisque certains endroits ne seront jamais sens équivoque. J’apprends à imaginer autrement, loin du labyrinthe, dans les prairies où l’on ne colonise rien et en écrivant ces lignes, je me demande, combien de femmes ont besoin d’apprendre à imaginer autrement ?
Il y a des jours où je voudrais grandir encore, pour changer de point de vue.